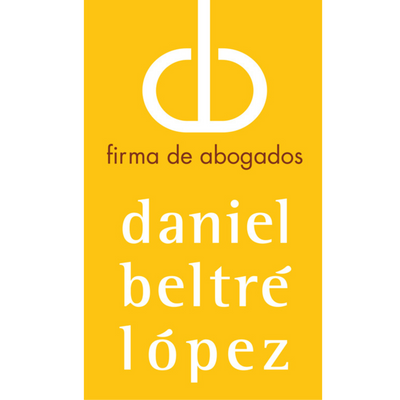On pourrait comprendre que puisque la personnalité juridique s’éteint avec le décès de la personne et que le droit à l’image est un droit très personnel, lié à l’existence même de l’individu, il ne serait pas justifié de protéger un droit présumé avoir succombé ; Cependant, la vérité est que le système juridique a fini par reconnaître des dimensions ou des manifestations du droit à l’image qui permettent d’exiger une compensation.
Ainsi, la loi n° 192-19 sur la protection de l'image, de l'honneur et de l'intimité familiale des personnes décédées et blessées, du 21 juin 2019, développe, bien que de manière limitée, le régime de protection de l'image, un droit hautement personnel consacré par l'article 44 de la Constitution dominicaine.
Il est curieux que le législateur ait décidé de se concentrer uniquement sur la réglementation de l’exercice des actions visant à protéger l’image des personnes blessées et décédées, laissant de côté l’intérêt légalement protégé des personnes au sens général, contre l’utilisation, quelle qu’elle soit, de leur image ; gaspiller un travail législatif qui aurait pu être utile pour préparer un cadre juridique complet concernant le contenu, la portée et la protection de l’image.
En effet, elle continue de laisser de nombreuses lacunes en matière d’images, tout en générant des ambiguïtés lorsqu’elle fait référence à la « reproduction non offensante » d’images ou à une « intrusion illicite causant de la douleur aux membres de la famille ». Et il convient de se demander : comment ce qui est offensant est-il conçu en termes universels ? Ou comment mesurer le niveau de chagrin ou de douleur chez un membre de la famille ? Ce sont des questions auxquelles la loi ne répond pas.
Dans notre pays, le droit d'injonction était ouvert et, bien que non expressément établi par une loi spéciale, la responsabilité civile et les dommages-intérêts étaient également possibles.
Cela est possible grâce au concept juridique de dommages « ricochet » ou dommages rebond, qui sont capables d'apporter des solutions à ce type de situations qui surviennent dans la sphère privée des individus, résolvant ainsi depuis longtemps le manque de législation spécifique sur le droit à l'honneur, à la dignité et à la vie privée des individus.
____________________________________________________________________________
Ainsi , lorsque le dommage causé à une personne entraîne un préjudice moral ou matériel pour autrui, ces victimes peuvent exercer, en leur nom propre, l'action en responsabilité civile, sans qu'il soit nécessaire d'avoir un lien de parenté entre la victime initiale et ceux qui ont été lésés « par rebond » ou « par affection » ; Cette action légitime le conjoint et les enfants de la victime initiale sans qu’ils aient besoin de prouver leur affection. Il existe une obligation pour les personnes extérieures à la famille de fournir la preuve de leur état, car celui-ci n'est pas présumé.
Il existe donc une tendance, tant au niveau législatif que jurisprudentiel, à distinguer le type d’action en justice en fonction de la qualité de celui qui l’exerce.
Par exemple, lorsqu'une violation du droit à la vie privée d'une personne décédée de son vivant a été constatée - ce qui n'est pas le cas de la personne impliquée dans l'accident - ce droit ne peut pas être protégé par l'amparo, car une fois que la personne propriétaire de ce bien personnel décède, il n'y a plus de domaine vital à protéger en tant qu'objet du droit fondamental, même si ses effets patrimoniaux peuvent persister.
Dans ces cas, des mesures visant à obtenir une protection civile et une indemnisation des tiers, qui peuvent être évaluées financièrement, seraient appropriées.
Toutefois, aucun tiers ne peut agir pour réclamer protection ou indemnisation pour les dommages causés par l'utilisation de l'image d'une personne, mais plutôt diriger ces dommages vers son honneur et sa vie privée familiale.
En principe, l’action visant à protéger le droit à la vie privée ne peut être exercée que par la personne qui détient ce droit et qui a été agressée ; Toutefois, le droit à la vie privée s’étend aux autres membres de la famille à laquelle on appartient, avec lesquels on entretient un lien étroit et spécial.
Toutefois, conformément à la nouvelle loi sur la protection de l'image, il est possible que, à la suite d'un préjudice, les actions en protection civile de l'honneur ou de la vie privée d'une personne décédée puissent être exercées par la personne (physique ou morale) que le défunt a désignée dans son testament, ou, à défaut, par le conjoint, les descendants, les ascendants et les frères et sœurs vivants au moment du décès de la personne concernée et, en leur absence, par le Ministère public, qui peut agir d'office ou à la demande d'une partie intéressée, dans les cas de personnes vulnérables ou incapables.
La loi semble également floue quant à savoir si des tiers peuvent réclamer une indemnisation pour dommages ou s'ils s'arrogent plutôt des pouvoirs qui ne leur sont pas applicables, car ils n'auraient pas qualité pour agir, puisqu'ils exerceraient une action visant à protéger des droits hautement personnels tels que l'image, la vie privée et l'honneur d'une personne décédée.
Ainsi, même lorsque le décès d’une personne entraîne l’extinction de la personnalité juridique et des droits qui lui sont inhérents, il est clair qu’il existe des moyens pour les membres de la famille de réclamer en justice une indemnisation pour le préjudice causé au défunt et à sa cellule familiale, dans la poursuite de la préservation de leur honneur, de leur mémoire et même de leur vie privée familiale.
L'auteur est avocat, expert en droit constitutionnel et
droit à la communication
Twitter : @gabrielabeltre