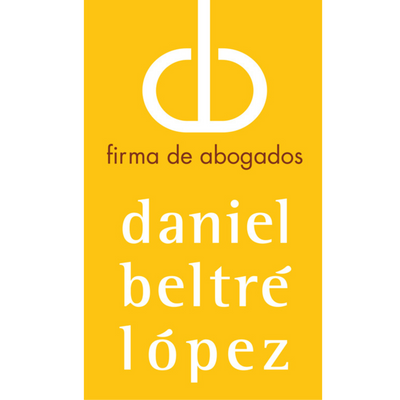Imaginez un système de radio et de télévision où il n’y a pas de règles et où personne ne supervise les personnes ou le contenu diffusé à travers cette communication audiovisuelle. Cet exercice ne nécessitera peut-être pas beaucoup d’efforts de votre part.
Imaginez maintenant ce que cela serait si les stations de radio et de télévision étaient soumises à un contrôle arbitraire de l’État, qui ne respecterait pas des droits tels que la dignité humaine, la liberté de croyance, la vie privée et la présomption d’innocence.
La régulation de la communication audiovisuelle, c'est-à-dire la communication adressée au public par la radio ou la télévision, quels que soient les moyens utilisés pour la mettre à la disposition du public, est une tâche urgente, car le bon exercice des droits de la personne qui communique en dépend, ainsi que la pleine jouissance des droits de ceux qui reçoivent l'information, en particulier les enfants et les adolescents, qui, en raison de leur situation de vulnérabilité, méritent une plus grande protection.
Toute société qui se veut démocratique, en vertu du respect de la liberté d’expression, doit accepter non seulement les idées ou expressions qui plaisent, ou celles qui sont considérées comme inoffensives, mais aussi celles qui choquent ou dérangent une partie de la population.
Il est intéressant de noter qu'en 1949, pendant la dictature, la loi n° 1951 sur la réglementation des spectacles publics et des émissions radiophoniques avait été promulguée, qui créait la Commission nationale des spectacles publics, d'où l'on pouvait déduire qu'elle avait vocation à réglementer la radiodiffusion et les spectacles publics.
Il ne faut cependant pas oublier que si ces dispositions réglementaient une activité sensible, qui touche de près les citoyens et qui est en grande partie responsable de leur développement socioculturel, il n’en est pas moins vrai que cet outil servait à réprimer tout pluralisme, car il devenait un instrument de censure de toute idée contraire au régime établi.
Ainsi, cette loi interdit la projection de films, nationaux ou étrangers, dans lesquels travaillent « […] des artistes reconnus comme communistes ou qui tendent à servir de propagande à l’idéologie communiste ».
_______________________________________________________________
Le règlement n° 824, pour le fonctionnement de la Commission nationale du divertissement public et de la radio, en date du 25 mars 1971, prévoit que les émissions de radio et de télévision doivent s'efforcer d'éviter les influences malsaines et perturbatrices sur le développement des enfants et des jeunes, respecter la moralité sociale, la dignité humaine et les liens familiaux, élever le niveau culturel du peuple, préserver l'identité, les coutumes et les traditions du peuple, exalter les valeurs de la nationalité dominicaine et renforcer les convictions démocratiques. Cependant, certains de ces objectifs n’ont pas été atteints ; d'autres n'ont été que précaires.
Il faut dire que le règlement n° 824, qui déclare la radio et la télévision d’intérêt public et qui prévoit une série de mesures visant à influencer la manière dont la communication s’effectue par le biais des médias audiovisuels, n’a pas la légitimité nécessaire pour réglementer les droits fondamentaux, et qu’il faut donc un nouveau cadre réglementaire pour la communication audiovisuelle, conforme à un État démocratique de droit et à un système constitutionnel moderne.
La pérennité d’un texte destiné à protéger les garanties dont bénéficient toutes les personnes est un signe de progrès. Bien qu'elle présente certaines lacunes et discriminations, elle représente toujours le seul instrument spécialisé pour établir des mesures et résoudre les conflits dans le domaine de la communication audiovisuelle.
Parmi les contributions de ce régime figurent la protection des enfants et de la langue, l’établissement de la responsabilité du directeur des stations de radio ou de télévision, la réglementation de la publicité, notamment pour les produits de santé et les cosmétiques, et la formation des diffuseurs, entre autres contributions.
Il convient de noter que la loi n° 6132 sur l'expression et la diffusion de la pensée, du 15 décembre 1962, reste à ce jour une référence pour l'interprétation du régime de responsabilité existant en matière de radio et de télévision ; ayant été appliquée au domaine audiovisuel, en l’absence d’une disposition juridique spécialisée adaptée à ce modèle de communication.
Cette loi établit un régime appelé liberté-responsabilité, résumé dans l'article 1 qui dispose : « L'expression de la pensée est libre, sauf si elle porte atteinte à l'honneur des personnes, à l'ordre social ou à la paix publique. »
_______________________________________________________________
Dans l’état actuel de notre droit, la seule censure qui trouve une justification est celle relative à la protection des enfants ; Toutes les œuvres audiovisuelles destinées aux mineurs doivent être soumises à un type de contrôle préalable, exprimé dans l'évaluation et l'approbation de l'organisme de régulation avant toute diffusion.
En ce qui concerne les autres programmes, projections ou diffusions, la responsabilité n'existe que pour les infractions qui pourraient survenir, sans préjudice des autorisations auxquelles les œuvres cinématographiques sont soumises.
Dans ces cas, on a eu recours au régime de responsabilité en cascade ou subsidiaire prévu par la loi n° 6132, qui, compte tenu de l'absence ou du manque de législation conforme à notre système constitutionnel et à notre époque, est venu remédier à certaines lacunes procédurales.
Français Conformément aux dispositions de l’article 46 de la Loi n° 6132 sur l’Expression et la Diffusion de la Pensée : « Les personnes suivantes seront passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des délits commis par voie de presse, dans l’ordre indiqué ci-dessous : 1.- Les directeurs de publications ou éditeurs […] ; 2.- En l’absence de directeurs, de suppléants ou d’éditeurs, les auteurs ; 3.- En l’absence des auteurs, les imprimeurs ; 4.- En l’absence des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs, les exploitants de cinéma, les annonceurs et les afficheurs […] » [1] .
En revanche, le directeur de la publication pourrait très bien se dissocier des publications ordonnées par la loi, ou de celles à caractère commercial ou des espaces payants, comme indiqué à l'article 46, partie in fine , de la loi n° 6132 sur l'expression et la diffusion de la pensée : « […] Lorsque la violation de la présente loi est commise par le biais d'une publicité, d'un avis ou d'une publication payante, apparaissant dans une publication ou diffusée à la radio ou à la télévision [2], l'auteur en sera considéré comme la personne physique ou les représentants autorisés de l'entité ou de la société qui l'a ordonnée, qui encourront la responsabilité prévue à l'alinéa 2 du présent article [3] . Toute publicité qui n'est pas strictement commerciale doit être publiée ou diffusée sous la responsabilité d'une personne déterminée. »
Toutefois, le régime de responsabilité applicable au type de communication produite par la radio et la télévision doit tenir compte d’éléments très spécifiques propres à la structure des médias audiovisuels, ainsi que du mode de diffusion des contenus, très différent de celui de la presse écrite, un domaine de communication expressément réglementé par la loi n° 6132 sur l’expression et la diffusion de la pensée.
________________________________________________________________
[1] La Cour suprême de justice a invoqué et déclaré l’inconstitutionnalité de cet article dans l’affaire Hipólito Mejía Domíngue z c. Wilton Guerrero Dumé et Osvaldo Santana sous prétexte qu’il est contraire à la liberté d’expression et d’information, ainsi qu’au principe du caractère individuel de la peine. Voir SCJ, Présidence, 17 avril 2013, n° 18-2013 - affaire Hipólito Mejía Domínguez c. Wilton Grerrero Dumé et Osvaldo Santana - en ligne http://www.suprema.gov.do/PDF/Datos_Adjuntos_Sentencia_2010_3051.pdf [Consulté : 17 avril 2013].
En France, par exemple, la loi du 29 juillet 1982 établit la responsabilité du directeur de la chaîne ou de l'établissement de radiodiffusion, comme auteur principal de l'infraction commise par voie audiovisuelle, lorsque le message incriminé a été revu avant sa communication au public, ou a fait l'objet d'une répétition pour son propre compte ; à défaut, celui de l'auteur ; et, à défaut, du producteur.
Dans notre pays, l'organisme désigné pour réguler l'activité radiophonique est la Commission Nationale des Spectacles Publics et de la Radio, dont la mission principale est « [...] d'empêcher que des spectacles publics et des émissions radiophoniques aient lieu en République Dominicaine qui offensent la morale, les bonnes mœurs, les relations avec les pays amis et en général qui peuvent nuire aux principes et aux normes du peuple dominicain » [1] .
La vérité est qu’avec le temps et le manque de réformes adéquates, cette institution a été touchée par l’obsolescence ; avide de matériel capable de répondre aux préoccupations d’une société souvent menacée par le simple fait d’allumer la radio ou la télévision. Cela pourrait sembler une position dramatique, mais pas improbable.
La Commission nationale du divertissement public et de la radiodiffusion réglemente certaines activités, tant le divertissement public que la projection d'œuvres cinématographiques dans les salles de cinéma, cette dernière étant limitée à la communication audiovisuelle.
Nous avons également observé des actions visant à corriger le discours des chansons, en particulier celles du genre urbain, en raison de prétendues distorsions de langage et de l’utilisation d’expressions moralement offensantes.
Bien entendu, même si des politiques culturelles et de protection de notre identité nationale, qui inclut la langue, doivent être élaborées, l’expression de la réalité culturelle populaire, qui nous parle de ses défauts, de ses souffrances et de ses désirs, ne doit pas être négligée.
________________________________________________________________
En ce qui concerne l’utilisation de termes ou d’images offensants, discriminatoires, dégradants ou insultants, des mesures correctives ou des sanctions doivent être appliquées.
Il existe en effet des mécanismes qui permettent aux artistes d’enregistrer des chansons avec la terminologie de leur choix, même si celle-ci est rejetée par l’organisme de régulation, à condition que la production musicale mise à disposition du public contienne un avertissement indiquant que sa vente est interdite à un segment de consommateurs spécifique, généralement les mineurs.
Même au niveau international, on peut citer des cas de chansons dont les paroles ont été partiellement supprimées, sans qu’il soit nécessaire de les censurer complètement, comme la chanson « Fuck you » de la chanteuse anglaise Lily Allen, dans laquelle le mot « fuck » a été supprimé ; De même, la chanson « I Want to Make You Wet » du rappeur américain Snoop Dogg, dans laquelle le mot « wet » a été remplacé par « sweat ».
Au niveau local, on peut citer certains cas de thèmes musicaux qui ont été interdits par la Commission nationale du divertissement public et de la radio. Bien qu’il y ait une tendance à parler de censure, ou de post-censure, il convient de se demander s’il ne s’agit pas plutôt d’un type de sanction, puisque la censure comporte un élément d’arbitraire qui, en principe, n’est pas caractéristique d’une sanction. La censure est d’application générale, tandis que les sanctions sont imposées en fonction des transgressions individuelles.
Dans le passé, certaines chansons ont été interdites dans notre pays, soit parce qu'elles contenaient des expressions à double sens, comme c'est le cas de « La gotera de Juana » de Félix Del Rosario, soit parce qu'elles contenaient des critiques politiques, comme c'est le cas de « El tabaco » de Johnny Ventura.
Il convient de rappeler le merengue « El guardia con el tolete » (Le garde au bâton), écrit par Enriquillo Sánchez - dont le titre original est « El zoo dominicano » (Le zoo dominicain), dans lequel des doubles sens étaient utilisés, et il a même été interdit - dit-on - « […] non pas à cause du garde, mais à cause du bâton. »
Johnny Ventura, célèbre interprète et compositeur populaire, a vu certaines de ses pièces musicales interdites par la Commission nationale du divertissement public et de la radio, alors dirigée par Doña Zaida Ginebra Viuda Lovatón, non pas précisément pour avoir utilisé un langage obscène, mais pour avoir prétendument induit une double interprétation, qui aurait violé les bonnes mœurs.
Ainsi, dans son merengue « Ley seca », Johnny Ventura a dit en plaisantant : « Ce Noël, je veux boire et si Zaida s'y oppose, que vais-je faire ? » , insinuant que la présidente de l'époque de la Commission nationale des spectacles publics, Doña Zaida Ginebra, était opposée à presque tout.
Et donc, on est passé d’une réglementation qui s’opposait à presque tout, à une réglementation qui ne s’oppose à presque rien.
Notre pays connaît certaines difficultés législatives dans le domaine de la communication audiovisuelle. En effet, en 2007, l’ancien président Leonel Fernández a nommé une commission chargée de réviser et de mettre à jour la législation actuelle sur les communications ; Ainsi, des projets de loi ont été élaborés concernant la presse, la radio, la télévision et l'Internet, parmi lesquels on note le projet de loi générale sur l'audiovisuel et le spectacle public, qui a soulevé la nécessité de créer un Conseil National de l'Audiovisuel et du Spectacle Public autonome.
En effet, cet organisme aura des fonctions très particulières qui, bien qu’elles touchent aux télécommunications, diffèrent des compétences attribuées à l’Institut dominicain des télécommunications (INDOTEL).
L'organisme de régulation des télécommunications, par exemple, a pour principales fonctions l'octroi de licences, d'autorisations, de concessions pour l'exploitation du spectre radioélectrique, l'attribution de fréquences hertziennes, entre autres ; Elle repose sur l'examen de certaines conditions techniques et économiques auxquelles doivent satisfaire les opérateurs fournissant des services de téléphonie, d'Internet, de radio, de télévision et de câble, ou les entreprises impliquées dans la structure des réseaux de communication.
D’autre part, la régulation audiovisuelle nécessite un organisme qui examine la qualité des contenus diffusés ; déterminer la pertinence d'une proposition de programmation ou d'un programme existant, en fonction de son contenu, c'est-à-dire des expressions, des sons ou des images diffusés à des fins d'information, d'éducation ou de divertissement.
A cet égard, le Conseil national de l'audiovisuel et des spectacles publics doit veiller à ce que les programmes de radio et de télévision respectent l'éthique de l'information, les règles du pluralisme culturel et politique, les quotas de production et de diffusion des œuvres nationales , les droits des enfants et des jeunes, les droits des femmes, le bon usage de la langue, le droit à l'image, ainsi que les autres droits des tiers. Il faudra veiller à ce que les communicateurs adoptent un nouveau style de reportage et de narration, moins agressif et plus protecteur de la dignité humaine. À cette fin, l’organisme de régulation peut superviser la programmation, évaluer les programmes, établir des grilles et émettre des avertissements, des sanctions ou interdire toute diffusion qui viole la loi.
La vérité est que nous avons besoin d’une norme juridique avec des critères de protection plus stricts pour les individus, une norme qui établisse un organisme qui ne soit pas perçu comme un superviseur ou un procureur, mais plutôt comme un organisme de réglementation et de conseil . Cela nous permettra de laisser derrière nous des réglementations qui ont été si précaires pendant si longtemps et de nous positionner pour évoluer vers une industrie audiovisuelle qui éduque les citoyens.